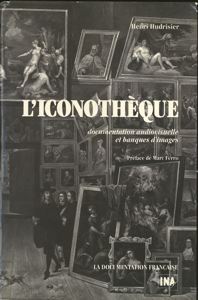
Visual quotations
| 1 | 15 |
| Bibliographic
description |
It was exactly that option that Hudrisier described in the last part of his book - in the terminology of that time without the vocabulary of graphic computer interfaces, which were still in their infancy. So he speaks of "tables that can exists in the form of a checkerboard of images electronically produced on a television tube" (p.96). We now speak of 'thumbnail menus' or 'thumb galleries'. Hudrisier's most far reaching insight however was not this technical setup (at that time based on videodisc technology), but his idea of what he called "interactive visualization": the full employment of the 'rapidity of the eye' in the process of image selection, which would put the traditional textual retrieval approach at a secondary level. Such an approach was and still is a revolution in the library and archive world where "textual dictatorship" reigns. Without denying the need for some context and description of images with text - as a tool for making a first sifting - the ability of the human eye to quickly survey thousands of images can be put to use and offers the best strategy for making selections. It allows a wide scope of selective criteria based on the visual, often beyond words, often more precise than any 'library thesaurus' or classification. Also, a reversal of search principles may occur, when an image will point the way to a certain text or context. Ideally, a search and selection system should allow the combination of both strategies.
This is not just a technical book on information storage and retrieval, but an attempt to view its subject (the iconotheque or audiovisual archive) from many angles: epistemological, historical, linguistically, anthropological, technical. Collection history, emblemata, anamorphose, mental images, media history with reference to camera obscura, the physionatrace with their pantograph, the camera lucida, early photography, stereoscopy, the influence of reproduction technology on the social usage of images, all such subjects are treated. It remains a pity that this visonary book has not been translated into English and missed its international audience.
2/14/2005 - 3/7/2005 Tjebbe van Tijen
quotation headers 16x ~ click red bullets to jump down and up or scroll
Pour établir la science de la classification des images, Hudrisier était parti, naguère, de l'étude d'un corpus bien défini: celui des photographies prises pendant les événements d'Algérie. Documentaliste et journaliste, il s'était interrogé sur les modes de classement possibles et avait fondé les prémisses d'une théorie de la classification. Il s'est aperçu depuis que les modes de classification étaient liés, chacun, à des savoirs, et à l'histoire de ces savoirs: celui des géographes, des médecins, des historiens, des linguistes ou des sémiologues, d'autres encore... Alors que, souvent, le chercheur classe pour ne pas penser, Hudrisier n'a pensé, lui qu'à classer pour penser et, désormais, pour classer, outre ces images, d'autres images. En passant, il nous suggère ainsi qu'il manque à notre réflexion une typologie des images: du dessin à la photo, en passant par la peinture et le croquis, de l'image immobile à l'image mobile (le cinéma) ou fluctuante (le relief); il pose simultanément les problèmes de leurs rapports - et de leur relation à ce qui n'est pas l'image - car, observe Hudrisier, accompagnez une image de sa légende, un film de sa bande-son, et voilà que changent tous les systèmes de significations... Devant les problèmes géants que posent ces interrogations, leurs solutions, Hudrisier s'aventure au travers des différents mondes de l'histoire, il y cherche une explication. Il se demande si l'enracinement de nos ignorances ne tient pas à la tradition religieuse, aux dogmes de l'iconoclastie qui ont paralysé le développement des recherches depuis Byzance, époque depuis laquelle l'Islam, aussi, a fait régner sa foi et juger l'image perverse. Certes, l'exemple et l'expérience de Léonard de Vinci et de la Renaissance italienne, se libérant de ces préjugés, vont à l'appui de son hypothèse. J'y ajouterai un autre aspect de la laïcisation du savoir, je veux dire la prééminence que les mathématiques, le nombre, le calcul jouent à partir du XVIe siècle, dans le développement de la science. N'est-ce pas pour autant que l'image est souvent irréductible au calcul, comme en témoignent les théories sur le nombre d'or, qu'elle s'est vue, précisément, écartée des processus traditionnels de constitution des savoirs : inventaire, classification, comparaison, expérimentation... ? Cet irréductible, Hudrisier s'efforce de le définir et de le traquer.
[p.7-8; Introduction par Marc Ferro; Hudrisier (1982) L'iconothèque]
L'iconothèque serait donc un lieu où peuvent s'organiser les signes iconiques, témoins laissés derrière nous. Une civilisation qui produit de plus en plus d'audiovisuel, mais qui ne serait pas capable de l'organiser, de le mémoriser et de percevoir des relations de construction, retournerait-elle à un analphabétisme culturel? Cette organisation, signes iconiques accumulés derrière nous est essentiellement dépendante des technologies de la mémoire de l'image. Les recherches en technologie de stockage - mémoire à très grande capacité et bonne performance en rapidité d'accès - sont doncle préalable à toute recherche en méthodologie des banques d'images. (...) La société d'expansion de l'information ne se heurtera-t-elle pas, à plus ou moins longue échéance, au même problème de croissance que la société industrielle? Cette facilité et cette baisse des coûts de la mémorisation et de la diffusion et télédiffusion de l'image confrontent notre civilisation non seulement à l'inflation de l'image mais, ce qui est plus grave encore, à une inflation des stocks d'images. Ce phénomène de la baisse d'importance relative en volume de l'archive ancienne, connu de l'historien, n'est pas propre à l'audiovisuel mais il faut y prendre garde.
[p.33-35; chapitre: Définition et évolution de l'iconothèque; Hudrisier (1982) L'iconothèque]
L'interdiction des images proclamées dans le Deutéronome n'a pas été rigoureusement suivie par tous ceux qui se réclament de la tradition d'Abraham, et sans jamais renier radicalement le texte, on a pu en voir plusieurs usages et interprétations. Dans une analyse fort brillante, Jean Joseph Goux, reprenant une théorie émise par Gilbert Durand, analyse les rapports psychanalytiques qui nous relient culturellement à l'image et à cette interdiction de la représentation. L'islam, le judaïsme, l'orthodoxie, le catholicisme occidental, le protestantisme ou le matérialisme marxiste et le freudisme, sont tous des héritiers de la colère de Moïse brandissant les Tables de la Loi, et de l'interdiction iconoclastique à rencontre des adorateurs du Veau d'Or. Ils sont aussi les fils de ces juifs quittant l'Egypte de récriture hiéroglyphique, symbolique et iconique, et partant fonder une civilisation de récriture alphabétique. Beaucoup plus qu'un simple épisode historique, cette interdiction de l'image concerne nos civilisations islamo-judéo-chrétiennes et détermine notamment leur rapport à l'abstraction et au refus de l'image ou de l'imaginaire. "N'est-ce pas la proximité ancestrale à l'exigence iconoclaste qui met Marx et Freud, ces fils infidèles mais indubitables du judaïsme, en posture de percevoir toute représentation comme imaginaire, et tout imaginaire comme méconnaissance. Ce qui revient à soupçonner de fausseté et d'illusion ce qui s'expose dans l'idéologie et ce qui se peint dans le fantasme? Au contraire du cœur chrétien qui adhère aux images (aux images saintes) et qui met sa foi dans leur vérite immanente, l'antique soupçon judaïque, qui porte sur toute représentation, semble souterrainement reconduit dans le geste retors par lequel, en Occident, après la victoire du rationalisme, Marx dénonce et démonte la "caméra oscura" de l'idéologie et Freud découvre les leurres et l'imaginaire". La science occidentale se pose donc, dans ses postulats fondateurs, comme "iconoclaste". De cette constatation peut partir une réflexion sur le travail préalable de distanciation par rapport à l'idéologie dominante iconoclastique que doit produire l'iconographie pour s'imposer comme science de la classification et de la communication des images. Un des points d'ancrage de cette réflexion sur l'iconoclastie marxiste pourrait s'appuyer sur la conceptualisation de la monnaie, la notion d'équivalent, chez Marx, considérée d'une part comme une transgression de la règle d'ïnterdiction fétichiste (le Veau d'Or est à la fois représentation divine et valeur précieuse d'échange), mais aussi comme circulation d'un équivalent général, d'une monnaie. Ne peut-on pas penser que notre civilisation, en ayant trouvé le moyen de faire circuler l'image, en accédant à l' "iconosphère", doit pouvoir repenser fondamentalement les problèmes d'économie politique de la circulation des signes, notamment, des signes iconiques, et revoir à cette occasion les fondements iconoclastiques du rationalisme positiviste? Notre civilisation de la communication s'inscrit justement dans cette possibilité entrevue d'une circulation possible de valeurs, considérée jusqu'à présent comme intérieure, imaginaire et insondable: l'image. La digitalisation de l'image, sa traduction en symbole binaire, lui donne la possibilité de circuler, de produire et d'être produite.
[p.61-62; sous-chapitre: Icône et iconoclastie; Hudrisier (1982) L'iconothèque]
L'information sur l'image doit être le fruit de plusieurs approches présentant des degrés divers dans l'échelle iconographie/iconologie. Ceux ci peuvent assez facilement être représentés dans des systèmes de documentation automatique moderne, par exemple des banques de données réparties sur des images. On peut imaginer qu'un centre s'intéressant à un sujet particulier se charge, pour les images qu'il connaît, de leur rassemblement iconographique ou catalogage, expérience relativement facile par télématique interposée ou le jeu des éditions de catalogues, et qui devient une expérience commune à toute la planète (c'est le catalogage des images). Pour les deuxième et troisième niveaux (c'est-à-dire l'analyse naïve, puis l'analyse savante de l'image), télématique et transfert télématique de l'image doivent aussi rendre de très grands services pourmettre en place cet accès à plusieurs niveaux. La possession réelle de l'image ne devient pas la raison principale d'analyser celle-ci ; l'image peut circuler, être nourrie de références externes émanant de centres documentaires spécialisés sur tel ou tel sujet. De ce fait, le photothécaire ou le cinémathécaire n'est plus le seul interlocuteur susceptible de donner des indications sur une image. Cette liberté lui permet alors de mieux "baliser" l'accès aux images, sans se perdre dans le détail de leur description (niveau iconologique).
[p.72-73; chapitre: Usage de la sémiologie dans le cadre de la documentation audiovisuelle; Hudrisier (1982) L'iconothèque]
Mais il nous semble que l'histoire de la technique, liée à celle de l'innovation en optique appliquée, répond mieux à l'interrogation d'un regard critique sur notre audiovisuel moderne: en quelques siècles, se succèdent la machine à dessiner de Durer, (la chambre noire) des moines italiens, puis ses héritiers de plus en plus perfectionnés, "caméra lucida" de William Hyde Wolleston (la chambre claire) et le "physionotrace" de Chrétien et Quenedey, breveté en 1788. Cette dernière machine à fabriquer des silhouettes était capable de fournir très rapidement un cuivre gravé, grâce à un système de pantographe relié à un curseur mobile qui permettait de suivre un contour sur un verre dépoli. Le physionotrace, véritable mariage de la machine a dessiner et de la chambre claire, situe bien le début de la future photographie dans une tradition analytique de l'image. Quant à la "chambre noire", c'est à la fois un outil d'analyse de l'espace et un appareil de mesure ou d'enregistrement de cet espace; la chambre noire est également un outil de 'reconstitution de cet espace, si on l'examine à travers l'histoire de la lanterne magique.
[p.91-92; chapitre: L'anamorphose, la machine à dessiner, la "caméra oscura" : une histoire de l'audiovisuel moderne; Hudrisier (1982) L'iconothèque]
Certes, la perte de cette tradition (analyse de l'espace par la chambre noire tj.) peut avoir d'autres causes, paradoxales peut-être: la généralisation de récriture, qui coïncide avec la perte d'importance de la réflexion religieuse et l'impossibilité nouvelle de pouvoir envisager la pensée ou la cognition par l'image. Lorsque Wheatstone construit un stéréoscope à miroirs qu'il garnit de dessins, on peut dire que s'il ne lui manque que la photographie pour être popularisé, il ne s'en inscrit pas moins dans le vaste mouvement de l'image anamorphosée. En 1850, le départ de l'image stéréoscopique est véritablement donné, la photographie permettant, mieux que le dessin ou la peinture, une précision dans le tracé des perspectives, susceptible d'apporter de véritables effets de relief. Il est intéressant d'observer l'évolution de l'usage social qui s'ensuit. La photographie en relief fut un véritable média de masse pendant toute la deuxième moitié du XIXe siècle, puis elle chuta, pour ne pas dire tomba en désuétude, avec le XXe siècle, date d'arrivée de la carte postaie et du cinéma. Elle n'est maintenue en vie que par l'acharnement passionné de quelques cercles restreints et certaines catégories de la recherche (notamment les cartographes). Trois hypothèses, donc au moins trois voies de recherche, pourraient être éventuellement explorées. Le relief d'alors demandait de la part de l'observateur d'images, un isolement complet et momentané d'avec le reste de la société, un moment de contemplation solitaire de l'image. Ne pourrait-on admettre que le cinéma, né en 1895 et qui crée lui aussi l'illusion de la troisième dimension, soit responsable de la désaffection de l'image relief en tant que média de masse? Par ailleurs, la salle obscure remplacerait la solitude nécessaire au visionnement du stéréoscope. Deuxième hypothèse concernant l'avènement de la carte postale: les vues stéréoscopiques étaient au siècle dernier l'objet d'éditions nombreuses. La naissance de la carte postale tue la troisième dimension de ces stéréogrammes, et il serait envisageable de penser que la troisième dimension perdue retrouve son équivalent dans une dimension de communication à distance, de communication postale. Dans une troisième hypothèse, on peut essayer d'apprécier ce que les procédés de photogravure de la fin du XIXe siècle et du début du XXe ont pu faire gagner à l'image en la situant également en communication spatiale, dans la mesure où produire des multiples d'une même image renforce et change son sens. Là aussi, l'image relief et stéréoscopique était "trop porteuse de sens", pas assez "cadrée" et "investie" d'un sens précis car un masque de communication (trop large de ses trois dimensions); même en dehors des problèmes techniques insurmontables, il lui fallait abandonner sa dimension relief pour pouvoir devenir image de magazine.
[p.92-93; chapitre: L'anamorphose, la machine à dessiner, la "caméra oscura" : une histoire de l'audiovisuel moderne; Hudrisier (1982) L'iconothèque]
Le regard qui est posé sur l'image elle-même influence aussi la perception que l'on a de l'image. Une grande image (par exemple, 10 mètres sur 7), vue à cinq ou à vingt-cinq mètres de distance, ne sera pas du tout perçue de la même façon, et ne produira donc pas le même effet de sens qu'une petite image. Léonard da Vinci insiste longuement sur ce problème dans ses "Carnets". Là encore, la standardisation des formats de journaux et surtout celle des tubes cathodiques (par leurs faibles dimensions) interdit d'englober par le champ de l'image, l'ensemble du champ visuel de l'interprétant (ce qui aurait pour effet de créer l'illusion du non-cadre). Ces cadres standardisés participent globalement à une donnée de notre époque qui favorise largement le "sémiotique", c'est-à-dire l'effet de sens obligatoire contre la possibilité des regards multiples. D'où la tendance déjà signalée à voir un spectacle de masse passer successivement du panorama, au cinéma, puis à l'écran de télévision, sans que l'on puisse la percevoir comme une régression, puisque, parallèlement, il y aurait progrès dans la définition d'un sens. Cette limite du cadre dans l'espace pourra aussi être perçue comme une limite temporelle au texte, comme un moment où s'arrête la possibilité pour le regard de cheminer dans l'espace textuel de l'image (espace du cadre de la photo): un masque de signification pose en frontière sur le réel. Hors du cadre et de la limite du plan, point de salut! Et donc, point de sens... De cette façon, le "photographique" trouvera sa correspondance non seulement dans un cadre cinématographique, mais aussi dans le début et à la fin de chaque plan. C'est dire que le plan cinématographique, traditionnellement considéré comme la plus petite unité cinématographique, se distinguera essentiellement du photogramme d'une image considérée comme parcelle d'image. Le plan cinéma sera donc, par rapport a la photographie, une image photographique multi-temporelle. Cet aspect multi-temporel donne au texte cinématographique une limite de "cheminement" dans l'examen de l'image, qui est borné par le début et la fin du plan. Ceci revient à dire que cadrage et découpage du scénario ne sont que deux éléments d'un même concept opératoire "limite de texte iconique". Les ouvertures et fermetures en iris, les recadrages dans l'image cinématographique, les travellings dans l'axe ou ceux qui continuent à viser un objet dans le centre du cadre, malgré le déplacement latéral de la caméra (aujourd'hui le "zoom") sont autant d'effets de sens par soustraction sur l'univers référentiel.
[p.96-97; chapitre: L'anamorphose, la machine à dessiner, la "caméra oscura" : une histoire de l'audiovisuel moderne; Hudrisier (1982) L'iconothèque]
Si l'on se penche sur la production filmique en relief, on croit pouvoir grossièrement constater que la plupart des "films en relief", produits dans le cadre "éternellement expérimental", ont une qualité artistique médiocre. D'où la désaffection des critiques cinématographiques et d'un public cultivé qui s'avoue à chaque fois déçu de voir l'accumulation des effets spéciaux transformer chaque "film relief" en un catalogue des trucages. Les artistes, confrontés à une nouvelle technologie de la communication, stéréo, laser, cinéma en relief, musique electroacoustique, synthétiseur, etc., se trouvent en possibilité de "régression" par rapport à remploi de la technologie en question ; ils arrivent, dans leur régression, à explorer d'abord le champ sensori-moteur de la technologie en question, puis accèdent à un développement de la perception par jeu de gammes d'essais sur la susdite technologie et finissent peut-être par la fonction sémiotique ou symbolique. Le passage, par ce raisonnement, de l'individuel au social (c'est-à-dire "école artistique" ou "culture d'une société") pourrait éventuellement fonctionner comme un modèle de recherche. En fait, plus banalement et comme nous l'avons signalé plus haut, si le relief au cinéma tarde tant à être employé, c'est qu'il est déjà là avec le mouvement. Quiconque a participé à un tournage de film, même en décor naturel, n'a pas manqué d'être surpris de voir les meubles se promener dans le décor, les suspensions ou les ampoules électriques monter et descendre, les tables se percher sur des cales de bois. "... L'hypothèse est que le cinéma, comme langage d'art - ou au moins uniquement vérifié et expérimenté comme tel - est une langue spatio-temporelle, et non audio-visuelle - sinon pour une première analyse au niveau matériel".
[p.104; sous-chapitre: L'espace et le relief du cinéma; Hudrisier (1982) L'iconothèque]
La différenciation classique que l'on a l'habitude de faire dans les iconothèques passe généralement par la frontière image mobile/image fixe. Il est entendu que cette différenciation reste efficace pour des raisons institutionnelles, pratiques, théoriques et techniques. Cependant, en ce qui concerne le point particulier de l'analyse de l'image, il peut être pertinent de regrouper d'une part les documents audiovisuels construits, narratifs, édités, et qui représentent un certain temps de spectacle, et les autres, c'est-à-dire les documents épars ou même les documents appartenant à un contexte que l'on veut pouvoir ignorer. Les photographies, même si elles s'insèrent dans un contexte (par exemple, montage diapositives, livre, reportage, etc.), sont généralement considérées par les documentalistes audiovisuels comme très facilement décontextualisables. Dans le cinéma ou la vidéo, ce phénomène existe aussi, mais de façon variable: pratiquement pas pour ce qui concerne les "films fiction"; moyennement pour les films de reportage dont les plans peuvent être réutilisés; beaucoup pour les films d'actualité, la réutilisation des plans d'actualité représentant une part importante des films historiques. La résistance à pouvoir réutiliser le cinéma ou la vidéo plutôt que la photo dans des contextes différents serait-elle due à cette vision globale et immédiate de l'image fixe s'opposant à la vision narrative du cinéma? Serait-elle due à la plus grande facilité qu'il y a, par la suite, à grouper (à utiliser dans le nouveau contexte pour lequel s'effectue la recherche) des photographies d'origines diverses plutôt que des plans d'images mobiles, qui posent souvent des problèmes de "raccord" insolubles (raccords de mouvement, d'ambiance, de lumière, etc.)? C'est ce qui explique la rareté du plan d'archives dans le film de fiction. En revanche, le film didactique ou historique rend nécessaire ces coupures temporelles; il est logique, dès lors, d'utiliser sans problème des plans d'archives. Plus souterrain est ce qui touche à la structure inconsciente des 'a priori' de l'analyse de l'image. Fixe, l'image sera facilement décontextualisée lors de son analyse par les photothécaires, même si elle appartient à un contexte précis (montage diapositives, par exemple). Mobile, l'image sera "cousue ensemble" et largement oubliée dans l'analyse au profit d'une vision globale du document qui prend sa signification dans la narrativité, au-delà des choses vues. C'est cette charge d'hyper-iconicité, ce degré d'iconicité, dont nous avons dit qu'il dépassait le référentiel, qui fait souvent oublier, dans l'analyse des films (et surtout l'analyse des films de fiction), de signaler tel ou tel plan qui pourrait être décontextualisé et resservir ensuite dans un tout autre montage.
[p.120-121; sous-chapitre: Documents épars : photographies, plans d'archives; Hudrisier (1982) L'iconothèque]
Nous avons vu que sous la Renaissance et à l'âge classique, "iconographie" et "iconologie" étaient deux champs distincts d'une même science de l'image. La communication par l'image, notamment la communication religieuse ou de tradition mythologique revêtait une importance considérable dans notre civilisation: iconographie et iconologie étaient des choses sérieuses sur lesquelles on spécialisait le savoir. Le savoir géométrique optique en est l'une des facettes. Le savoir iconographique (nous dirions aujourd'hui le catalogage) est une autre facette. Le savoir iconologique, que nous définirions aujourd'hui comme facette sémantique, discours sur le signe et le symbole, en est encore une autre. En demandant une séparation des champs de réflexion sur l'image, nous ne ferions donc que renouer avec une attitude traditionelle. Si les "indexeurs-analystes" institutionnels de l'image photographique ou filmique ont souvent perdu cette tradition, il semble possible de la retrouver soit chez des gens de l'esthétique comme Panofsky ou Francastel, soit chez des théoriciens du cinéma comme Epstein, Eisenstein, Bazin, Pasolini, Christian Metz, dans les "Cahiers du cinéma", la revue "Positif", etc. C'est donc à travers ces écrits que quelques pistes de recherche, utiles à l'iconographe moderne, pourraient être dégagées, par exemple l'essai d'un travail commun, rendu possible par l'interconnexion, informatique ou télématique, de plusieurs centres documentaires autour d'un même corpus. Libéré de la lourde tâche d'un travail iconologique sur lequel il "bricole", et assuré qu'un travail de ce type peut éventuellement être réalisé ailleurs, certain qu'il pourra lui-même l'utiliser et permettre à d'autres d'y accéder et de l'utiliser, le documentaliste audiovisuel pourra se consacrer a son travail iconographique et établir sciemment les règles de ce jeu passionnant: "guider" des chercheurs vers l'image pertinente. A l'inverse, les iconologues modernes - chercheurs en esthétique, critiques d'art, spécialistes de toutes sortes de collections d'images - auront tout à gagner de ces retrouvailles avec la tradition de deux niveaux d'analyse de l'image, libérés, comme ils pourraient l'être, de la lourde tâche iconographique, largement automatisable grâce à des banques de données iconographiques informatisées.
[p.132-133; sous-chapitre: Apport théorique de la recherche esthétique : iconologie/iconographie; Hudrisier (1982) L'iconothèque]
La voie linguistique de la documentation image n'est donc pas la seule voie possible. Associée aux "vieilles recettes" irremplaçables de la documentation (les mots clés), l'organisation des photographies par paquets, par "nuages" (unidimensionnels ou multidimensionnels) peut être une voie rapide pour trouver des photographies dans un stock. Jusqu'à présent, la manipulation de ces objets (diapositives, photos "papier") était longue et fastidieuse. La communication courante était de type narratif: album, projection de diapositives. Maintenant, est en train de naître un nouveau média: la possibilité de pouvoir jouer avec un stock d'images, noter des indexations, y revenir par un programme automatisé, fabriquer un itinéraire de photos, le remodifier, le tout, sans peine aucune. C'est par référence à ce nouveau média - l'accès aléatoire au stock d'images - que nous proposons, à titre d'hypothèse de recherche, le parcours visuel d'une photothèque "sans indexation". (...) Etant donné la rapidité du regard sur les documents primaires (les photos) que nous signalions plus haut (10 minutes/500 photos), la lenteur relative de la construction d'une requête verbale, et aussi le rétrécissement du choix de réponse de l'ensemble documentaire, au fur et à mesure que l'on poursuit la construction de la requête verbale, comment définir un équilibre langage textuel/langage image dans une banque de données iconographiques? Pour cela, il est essentiel d'élaborer une méthodologie spécifique de la banque d'images, impliquant un regard critique sur les habitudes en matière de documentation audiovisuelle. Et surtout refuser de se conformer à ce vieil adage qui voudrait que ce qui bon pour la bibliothèque soit nécessairement bon pour tout autre système documentaire ou,? ce qui revient au même, que tout objet non-texte doit être d'abord traduit en texte, puis traité comme tel ...
[p.143-144; chapitre: Analyse documentaire et visualisation interactive; Hudrisier (1982) L'iconothèque]
Lorsqu'on lit les historiens de l'art contemporain, à propos de l'invention de la gravure à l'eau-forte on est frappé de constater que cette innovation fut, a l'époque, ressentie comme un média d'avenir, un moyen sûr de parvenir à une meilleure connaissance de l'art, élargie à l'image iconographique ou iconologique. Grâce à cette possibilité d'imprimer des multiples d'un seul tableau, de posséder la trace visuelle des œuvres en de nombreux endroits, la gravure répondait au désir de les comparer, les étudier, les commenter, les classer et de pouvoir les consulter lorsque le besoin s'en faisait sentir, Celui qui se risque aujourd'hui au hasardeux travail prospectif, sent bien, lui aussi, que, comme au temps de l'invention de la gravure à l'eau-forte, nous arrivons à un tournant de la communication de l'image. Des techniques comme le vidéodisque, la fibre optique ou le satellite préparent, en effet, chacune dans un champ différent, une mutation de la communication et surtout de la documentation de l'image. Ce progrès technique, cette possibilité de voir la référence audiovisuelle plus répandue parce que moins chère, moins difficile à obtenir et plus rapide dans son accès, ne doit pas être regardée comme une simple loi du progrès, un changement quantitatif destiné à faciliter la vie des responsables de centres audiovisuels; c'est une véritable révolution cognitive qui nous est proposée. Cette révolution transite par un point de passage obligatoire: les banques de données iconographiques. Nous commencerons par remettre en cause une attitude qui consiste à n'envisager la "visualisation" que comme perfectionnement de la documentation-image traditionnelle, sans bouleverser les habitudes documentaires (logiciels, fichiers, etc.). Nous pensons, au contraire, que la "visualisation rapide et interactive" est comparable au phénomène que représente l'apparition de l'estampe à l'époque de la Renaissance: c est une révolution dans la conception même de la "banque d'images" qui suppose une organisation totalement nouvelle: poste de travail différent, banque d'images répartie, nouvelles formes de logiciel documentaire-image...
[p.147-148; Quatrieme partie: La banque de données audiovisuelles; Hudrisier (1982) L'iconothèque]
Nous évoquions la différence du temps de lecture d'un document cinéma par rapport à une photographie. Cette différence existe aussi entre le texte et la photographie. Le texte met un certain temps à être élaboré et perçu, alors que la photographie est perçue dans sa globalité, immédiatement. Cette constatation nous amène à reconsidérer certains paramètres d'économie temporelle dans l'accès à une banque de données iconographiques d'images fixes. Imaginons, par exemple, que l'on interroge pendant vingt minutes, un système documentaire quelconque pour en "sortir" cinquante références narratives (texte ou film); cela représente un certain équilibre entre interrogation et consultation (vingt minutes d'interrogation comparées à quelques jours de consultation). En revanche, le même ratio - 20 minutes/50 références - sera parfaitement ridicule dans une collection de photographies, ces cinquante photographies pouvant être regardées en moins d'une minute. Cette économie temporelle dans l'accès à la photographie ou à l'image fixe sera encore radicalement modifiée, si on peut utiliser l'outil tabulaire dans l'accès documentaire aux images fixes. On sait combien la documentation bénéficie de cet outil merveilleux qu'est la "table des matières": l'index ou le "menu", selon le jargon des informaticiens. Il s'agit de mettre sur la même page un certain nombre d'informations sommaires, certes, mais qui sont une des étapes documentaires vers l'accès aux documents primaires qui seront les textes, les paragraphes, les articles que l'on recherche. Pour la photographie ou l'image fixe, ces "tables" peuvent exister sous forme de damier d'images, produit électroniquement sur un tube de télévision. Ces damiers ont pour nous un double avantage: accès comparatif aux images, plus grande rapidité de perception pour effectuer des tris rapides sur de grosses quantités d'images. La première qualité, l'accès comparatif, existe en deux lieux de la chaîne documentaire, en début et en fin de chaîne. Au début, il s'agira de choisir parmi des images éloignées les unes des autres dans l' "espace documentaire". En fin de chaîne, il s'agira 'de choisir plus finement entre des images proches les unes des autres, par rapport aux hypothèses de travail de la personne qui effectue la recherche.
[p.154-155; sous-chapitre: Le damier d'images; Hudrisier (1982) L'iconothèque]
L'imagerie mentale est une évidence qu'attestent les rêves et les souvenirs visuels auxquels nous sommes tous soumis. Cependant, dès que nous arrivons à nous poser la question "Pense-t-on avec des images?", il devient très difficile de mettre au point des processus expérimentaux. Einstein et Poincaré prétendaient se représenter les problèmes sur des sortes de tableaux noirs sur lesquels ils dessinaient mentalement des figures sommaires. Ce qui est intéressant dans l'histoire scientifique de l'exploration expérimentale de l'image mentale, est la façon dont - faute de méthode expérimentale satisfaisante - le problème, pourtant très en vogue au début du siècle, a pu être pratiquement évoqué jusqu'aux années 50. Cette lacune scientifique, qui est dans la même ligne idéologique que l'iconoclastie, peut être en partie responsable de cette tendance qui consiste à penser qu'une iconothèque est équivalente à une bibliothèque quant à la résolution de ses problêmes documentaires. Que représentent exactement ces images mentales sur le plan biophysiologique? Quel peut être leur usage documentaire? On n'a pas pu cerner précisément la structure nerveuse des images mentales et la façon dont elles sont stockées, mais on a déjà pu expérimentalement déterminer certaines de leurs qualités. On s'est notamment rendu compte que les images mentales se comportaient comme si elles étaient des objets spatiaux, rigides, colorés, etc. On a également pu mettre au point des processus expérimentaux qui ont permis de décider que, géométriquement, l'esprit avait à cheminer à l'intérieur de l'image mentale. L'orientation spatiale de l'image mentale mémorisée a donc une importance: une plus grande distance à parcourir donne des temps de réponse plus longs; une rotation de l'objet à reconnaître dans un plan ou même dans l'espace retarde aussi cette mémoire; ces images mentales ont également une échelle relative qui retarde le temps de réponse et nuit à la finesse des informations stockées (il faut à l'intelligence le temps nécessaire pour "zoomer" les images mentales). Citons à titre d'exemple le processus expérimental mis en œuvre pour répondre à la dernière question. Ainsi un judicieux usage des potentialités humaines en image mentale peut contribuer au bon fonctionnement de la documentation audiovisuelle dans la mesure où l'imagerie mentale est une qualité qui peut s'éduquer et s'améliorer. Une utilisation documentaire de l'image mentale - déjà mise au point par les Grecs et dite méthode des "loci" - consiste à retenir des listes (par exemple des listes d'achats à faire) en associant chaque mot à un itinéraire familier, mémorisé une fois pour toutes. Il ne reste plus, pour se remémorer la liste d'achats, qu'à courir à nouveau mentalement l'itinéraire que l'on a préalablement jalonné avec les objets de la liste.
[p.171-174; sous-chapitre: Imagerie mentale et documentation audiovisuelle; Hudrisier (1982) L'iconothèque]
Cette banque visuelle s'inscrit dans un système interactif et documentaire de visualisation par photogrammes, raccordé a la banque d' "abstracts". Il est prévu d'associer à cette banque un système de visualisation interactive par plan séquence ou document. On peut également envisager des banques photographiques associées (photos de plateaux, de presse ou photos publiées) et connectées à la banque visuelle. D'autre part, nous avons théoriquement prévu un accès textuel à la description d'une "textualité" visuelle et spatiale. Autrement dit, on ne s'interdit pas de penser que des analyses filmiques, telles qu'elles sont pratiquées actuellement par des théoriciens du cinéma, puissent être prises en compte. Mais, à notre avis, il ne s'agit pas d'un élément primordial du système. Cette base documentaire pourrait être largement constituée par des instances de production et de réalisation (élaboration et plan de découpage) ainsi que par certaines exégèses, travaux universitaires ou recherches spécialisées. De la même façon, une banque gestuelle ou une banque chorégraphique ne figurent sur l'organigramme que pour mémoire: elles constituent un point d'entrée pour des instances de recherche qui ont actuellement beaucoup de difficultés à obtenir des corpus et des moyens d'analyse; ces recherches restent aujourd'hui peu connues et donc peu utiles à la collectivité, alors qu'elles pourraient trouver dans le raccordement à un tel système un moyen d'expression et un usage documentaire certain.
[p.187-188; sous-chapitre: La banque d'analyse visuelle; Hudrisier (1982) L'iconothèque]
Avec l'apparition d'une certaine forme de mémorisation de l'image - la photographie, le cinéma, la télévision -, on a déjà pu observer les prémices d'une prise en compte sociale de l'audiovisuel. Or, ce qui importe - et cela ne pourra se faire qu'au fil des générations -, c'est la conscience d'une culture générale audiovisuelle, le refus d'une pratique, uniquement professionnelle, de récriture audiovisuelle, et la volonté d'entreprendre une éducation visant à développer le sens esthétique. Susciter la conscience d'une culture audiovisuelle signifie, par exemple, d'avoir recours à des pratiques néo-académiques: la reconnaissance des "belles-lettres" audiovisuelles se traduira par une hiérarchisation des images, donnant lieu à une approche historique de la photographie, du cinéma et de la télévision. L'image, pas plus que le texte littéraire, ne peut continuer à vivre, dans l'implosion du temps et de l'espace, les dures lois de sa seule distribution marchande. Et c'est sans doute par l'école que cette réappropriation de l'image s'opérera de la manière la plus naturelle: loin du discours traditionnel de type "communication de masse-sémiotico-publi-pédagogique", s'impose une éducation fondée à la fois sur une pratique de l'audiovisuel - vidéoclub, photo-club - et sur une large initiation au dessin, au théâtre, à l'histoire des techniques et des arts visuels. La naissance d'une véritable culture de l'image ne se produira qu'après décantation de ces directions éducatives. Les Grecs, entre le VIIe et le Ve siècle avant J.-C. sont parvenus à cette réflexion culturelle et à la mise au point d'un projet démocratique et éducatif d'appropriation sociale de récriture et de rejet (provisoirement) définitif d'une pratique professionnelle ésotérique de récriture (les scribes, les prêtres et les comptables). Les grecs ont ainsi permis l'émergence d'une civilisation de l'écrit, à la fois décentralisée et partie prenante d'une seule et même culture, mais ils ne l'ont fait qu'à travers mariage d'une réflexion à la fois d'ordre philosophique, technique, institutionnelle et sociale. Notre société doit, elle aussi, savoir se donner les moyens d'accéder à une civilisation audiovisuelle (parallèlement à une civilisation informatisée).
[p.198; Conclusion: Une culture générale audiovisuelle; Hudrisier (1982) L'iconothèque]